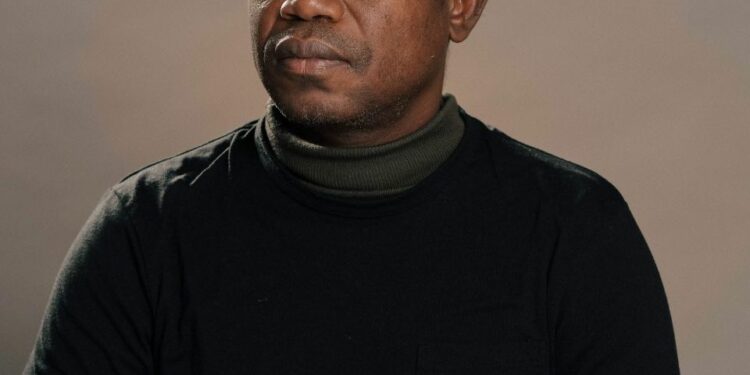À Thiès, le maire de la ville tente aujourd’hui de nous faire croire qu’il ne s’est agi que d’un banal chantier, d’une opération ordinaire d’aménagement urbain. Je le dis clairement : c’est faux. Ce qui s’est produit est un acte politique. Et comme tout acte politique, il doit être nommé, assumé et jugé.
La destruction de la fresque en mosaïque de Papa Ibra Tall n’est ni neutre ni anodine. C’est un geste de violence symbolique, une atteinte grave à la mémoire artistique, une violation du droit moral, et surtout un heurt brutal porté à l’histoire de la ville de Thiès. Lorsqu’on s’en prend à une œuvre fondatrice de l’espace public, on ne touche pas seulement à la pierre ou à la mosaïque : on atteint la conscience collective.
Cette fresque, réalisée au milieu des années 1970 sur la Place de France, n’était pas un décor interchangeable. Elle faisait partie de l’âme de la ville. Elle portait la vision d’un artiste majeur qui, dès son retour au Sénégal en 1960, a fait le choix courageux d’inscrire une pensée africaine moderne dans l’espace public, dans la durée et dans la matière. La détruire, c’est effacer une page de notre histoire intellectuelle, visuelle et politique.
Il faut le dire sans détour : le droit moral a été piétiné.
Le droit moral protège le lien indissociable entre un auteur et son œuvre. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il ne dépend ni des humeurs des équipes municipales, ni des urgences électorales, ni des logiques de communication. Aucune autorité locale n’a le droit de mutiler, de modifier ou de faire disparaître une œuvre, même lorsque les droits économiques ont été cédés. Ce principe n’est pas un luxe d’intellectuels : c’est un fondement de l’État de droit culturel.
Ce qui choque particulièrement dans cette affaire, c’est la confusion volontaire ou assumée, entre restaurer et reproduire. Restaurer, c’est respecter la matière originale, réparer sans trahir, prolonger la vie de l’œuvre en conservant son histoire. Reproduire, c’est fabriquer une copie : un substitut, une négation de l’original. Détruire une fresque en promettant une reproduction ultérieure n’est pas une politique culturelle : c’est une imposture institutionnelle. Aucune copie, aussi fidèle soit-elle, ne remplacera jamais une œuvre façonnée par le temps, par le geste de l’artiste et par la mémoire collective d’une ville.
Regardons ailleurs, sans complexe. À Paris, la modernité ne s’est jamais construite contre l’histoire. On y restaure des bâtiments centenaires, on protège les façades, on conserve les traces du passé, au point que même les tunnels, les stations et les sous-sols deviennent des lieux de mémoire, parfois de véritables musées. Là-bas, on a compris qu’on ne développe pas une ville en effaçant ses strates, mais en les assumant.
À Thiès, au contraire, ce qui s’est passé révèle une vision inquiétante : celle d’un pouvoir local qui traite l’art public comme un mobilier urbain jetable, sans valeur symbolique, sans profondeur historique, sans responsabilité patrimoniale. C’est une vision utilitariste, pauvre et dangereuse. Elle bafoue le droit de divulgation, le droit au respect de l’œuvre, et humilie la mémoire de Papa Ibra Tall autant que celle des Thiessois.
Thiès fut autrefois dirigée par Léopold Sédar Senghor, pour qui la culture était un pilier de l’émancipation, de la dignité et du développement. Voir aujourd’hui l’un de ses successeurs piétiner cet héritage est une douleur profonde, mais aussi un révélateur : on ne détruit pas l’art par accident, on le détruit par choix.
Une ville qui détruit ses œuvres fondatrices se condamne à l’amnésie. Un pouvoir qui efface l’art efface aussi le sens, la mémoire et la dignité.
Nous demandons des comptes, non par nostalgie, mais par responsabilité politique et historique. Car l’art n’est pas un obstacle au développement : il en est la conscience, la boussole et la mémoire.